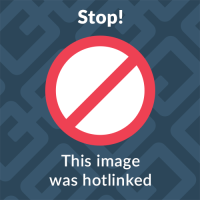Les originalités de la 6ème dissolution de la Ve République
Le dimanche 9 juin à 21 heures, le chef de l’Etat, utilisant les prérogatives de l’article 12 de la Constitution, a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale. C’est la sixième fois depuis 1958 que le mandat en cours des parlementaires est interrompu à la surprise générale. La démonstration est à nouveau faite que le droit constitutionnel est une matière vivante !

Par Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, professeur de droit public à l’Université de Brest.
Quelles sont les singularités de cette décision du Président ?
D’abord, la surprise. Telle n’était pas le cas en 1997 où la presse commentait largement cette perspective bien avant la décision du 21 avril. Ni en 1981 et en 1988 puisque l’élection de François Mitterrand rendait cohérente la recherche d’une majorité parlementaire. Pas plus en 1968 où l’aller-retour à Baden-Baden laissait présager une intervention de De Gaulle face aux tensions que traversait le pays. Au vrai, seule la dissolution de 1962 a pris les citoyens, comme les parlementaires, au dépourvu.
Ensuite la motivation. Pierre Avril, dans un commentaire de l’article 12, crée deux catégories : les dissolutions « royales » décidées pour sanctionner un parlement (1962) et les dissolutions « ministérielles » destinées à clarifier une situation politique (1981 et 1988). Cependant, ce double critère découlait d’un diagnostic commun : la volonté de dénouer une crise par l’appel aux citoyens. Comme le disait en 1996 Jacques Chirac (avant d’oublier son propre avertissement), « La dissolution n’est jamais utilisée pour convenir au Président mais pour résoudre une crise politique ». Quel sens vont donner les Français à la décision d’Emmanuel Macron ? Quelle crise cette dissolution est-elle réputée trancher ?
Enfin, sa rapidité d’exécution. En convoquant les électeurs pour un premier tour le 30 juin, cette campagne électorale sera la plus brève de toute l’histoire politique de la Ve République. L’explication tient aux contraintes de la Constitution (l’alinéa 2 est précis : « les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ») et au contexte (le 14 juillet est férié ce qui aurait complexifié l’organisation du scrutin et naturellement le calendrier olympique),
Quelles sont les incertitudes qu’elle fait naître ?
Toute dissolution est un calcul reposant sur des gains espérés. Dans le cas d’espèce, le Président espère probablement y trouver la force d’un nouvel élan pour terminer un quinquennat qui s’apparente pour le moment à un chemin de croix. Et sous ce rapport, il n’avait plus guère de choix pour tenter de reprendre la main. Il avait déjà bouleversé son organisation ministérielle par la nomination inattendue de Gabriel Attal le 9 janvier dernier. Il avait intensément mobilisé l’arsenal constitutionnel de domestication du Parlement à l’occasion des derniers chantiers législatifs (réforme des retraites et loi sur l’immigration). Et depuis des semaines, il avait multiplié les interventions médiatiques pour expliquer le sens de son action. En conséquence, il ne lui restait que trois options : faire le gros dos devant l’échec de dimanche soir, convoquer un référendum ou prononcer la dissolution.
Ce choix est par essence risqué, car une défaite de Renaissance en juillet suscitera des appels à sa démission. Surtout si le Président, comme il en manifeste l’envie, décide de s’engager pleinement dans la bataille électorale. Un revers ou, pire, une déroute lui seront imputés.
Un tel investissement nous rapprocherait de la pratique britannique où la dissolution repose pareillement sur des paramètres tactiques. Sauf qu’en Grande Bretagne, le Premier ministre, quand il renvoie les Communes devant les électeurs, met son poste en question. Rishi Sunak a ainsi pris le risque de devoir quitter le pouvoir le 4 juillet prochain. A l’inverse en 2017, Theresa May avait été confirmée dans sa responsabilité, même si le parti conservateur avait perdu la majorité absolue à Westminster. En France, jusqu’à présent, la dissolution n’a jamais porté préjudice au mandat du Président. Mais les prédécesseurs d’Emmanuel Macron, qui avaient tous fait connaître leur préférence, voire avaient invité les électeurs à les soutenir, s’étaient cependant gardés de s’investir pleinement.
La troisième incertitude tient au terme du mandat de député qui s’ouvrira le 7 juillet. Durera-t-il cinq ans ? Ou au lendemain de la présidentielle de 2027, le nouvel élu copiera-t-il François Mitterrand en décidant d’abréger la XVIIe législature ? Dès lors, à quoi serviront les trois prochaines années ? Compte tenu de l’état économique du pays, une transe électorale permanente est-elle propice à la résolution des nombreuses difficultés qu’il traverse ?
Quelles conséquences probables entrainera-t-elle ?
Probablement beaucoup plus de contentieux électoral qu’à l’habitude. A l’issue des élections législatives de 2022, le Conseil constitutionnel avait été saisi de 99 recours dont 7 avaient abouti à des annulations. Il y en avait eu 297 en 2017 et 8 annulations. Compte tenu de la précipitation avec laquelle cette décision a été annoncée, il est à craindre qu’en découle une insécurité juridique préjudiciable au bon déroulement du scrutin. Ainsi, dès le 10 juin, l’Association des maires de France, par un communiqué, a « alerté » sur les difficultés matérielles, soulignant la « réelle inquiétude chez de nombreux maires sur la capacité des communes à organiser ces deux scrutins dans des conditions satisfaisantes ». De même, par un tweet, le professeur Mathieu Carpentier a relevé que le décret portant dissolution de l’Assemblée nationale, publié au Journal officiel du 10 juin 2024, ne contenait curieusement aucune disposition sur son entrée en vigueur. Et quelle conséquence tirer du fait que les électeurs antillais et guyannais voteront le samedi 29 juillet (dérogation organisée par l’article L153 du code électoral), ce qui ne semble pas conforme à l’alinéa 2 de l’article 12 de la Constitution déjà évoqué ?
De manière plus certaine, l’Assemblée renouvelée sera convoquée le jeudi 18 juillet, puisque l’article 12 (mais dans son alinéa 3) prévoit qu’elle « se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection » et « si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire », ce qui sera le cas, « une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours ».
Comme cette installation solennelle découlera d’une dissolution, la session extraordinaire se tiendra « de plein droit », ce qui veut dire que le Président de la République n’aura pas à prendre un décret comme l’article 30 le prévoit pourtant.
Un nouveau gouvernement sera parallèlement nommé. Si la constitution n’oblige en rien Gabriel Attal à démissionner, même en cas de défaite de Renaissance, la tradition de la démission de courtoisie est cependant immuable depuis la IIIe République. Il rejoindra alors Bernard Cazeneuve dans le palmarès des chefs de gouvernement dont les fonctions furent les plus brèves.
Enfin, le Sénat demeure la seule institution préservée de tous les vents. Si par civilité, elle ne se réunira plus en séance publique, ses travaux parlementaires continueront. Et la parole de ses autorités, dont son président, raisonnera inévitablement comme un repère dans une période qui en est singulièrement dépourvue.