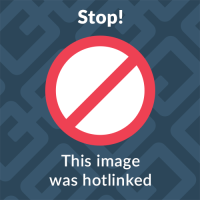La dénonciation unilatérale de l’accord franco-algérien de 1968 : un non-sens juridique et contre-productif ?

Par Serge Slama – Professeur de droit public à l’Université Grenoble-Alpes – CRJ – Affilié à l’Institut convergences migrations (ICM)
Prolongeant de précédentes déclarations et des prises de position dans le même sens que plusieurs personnalités politiques de droite ou d’extrême-droite (Patrick Stéfanini, Éric Ciotti, Marine Le Pen, Marion Maréchal…), l’ancien Premier ministre Edouard Philippe soutient l’idée, dans un entretien à L’Express, de « remettre en cause l’accord de 1968 avec l’Algérie ». Cette proposition s’appuie notamment sur l’analyse politico-juridique d’un ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt dans une note pour la Fondapol de mai 2023 selon laquelle « l’accord de 1968 prive le législateur et le gouvernement français de la possibilité d’agir significativement sur les flux en provenance de l’Algérie ». Pourtant cette idée, peu crédible juridiquement, pourrait avoir l’effet inverse de celui recherché…
Est-il possible juridiquement de dénoncer l’accord franco-algérien de 1968 modifié ?
Comme l’explique lui-même Xavier Driencourt dans sa note pour le « think thank libéral et progressiste », l’accord conclu le 27 décembre 1968 entre les gouvernements français et algérien, complété par plusieurs avenants et échanges de lettres en 1985, 1994 et 2001, ne comporte aucune clause expresse de dénonciation. Dans ce cas de figure, l’article 56 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit expressément qu’un tel traité ne peut faire l’objet de dénonciation unilatérale à moins, soit qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une telle dénonciation, soit que le droit de dénonciation « ne puisse être déduit de la nature du traité ». Or, rien dans la lettre de l’accord de 1968, ni dans les circonstances de son adoption, ne permet de penser que l’intention des gouvernements était de permettre la dénonciation unilatérale de celui-ci. Bien au contraire, les travaux socio-historiques consacrés à cette période démontrent que, lors de la négociation, « les négociateurs algériens jouent notamment sur l’expiration des délais prévus par les accords précédents [de 1964] pour renégocier à partir du régime de liberté de circulation établi à Evian. Ainsi, en 1967, et ayant bien compris que les agents du ministère de l’Intérieur français craignent plus que tout un retour à un régime de liberté de circulation, ces derniers « jouent la montre » »[1]. L’accord stipule lui-même dans son préambule que les deux gouvernements sont « soucieux d’apporter une solution globale et durable aux problèmes relatifs à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français ».
Dénoncer unilatéralement l’accord de 1968 constituerait donc une violation du droit international, au risque de saisine par l’Algérie de la Cour internationale de justice de La Haye. Certes, en vertu du principe de souveraineté nationale, si un Etat veut dénoncer un accord, il le peut toujours. Mais, sauf circonstances exceptionnelles, cela ne peut se faire, dans le cadre de relations pacifiques entre deux Etats, sans respecter certaines formes et délais et sans ouvrir préalablement des négociations bilatérales. Curieusement, pour l’ancien ambassadeur cette dénonciation unilatérale de l’accord « serait non pas « l’arme atomique » mais plutôt l’ultime avertissement pour obliger Alger à renégocier, ce qu’il s’est toujours refusé à faire ». Dénoncer d’abord, négocier ensuite. Cette curieuse conception des relations diplomatiques peut surprendre.
Et ce d’autant plus que cette dénonciation pourrait être contre-productive et avoir l’effet inverse de celui recherché…
En quoi cette dénonciation unilatérale pourrait être contre-productive ?
Une telle dénonciation unilatérale serait contre-productive pour deux raisons. En premier lieu, il faut bien comprendre l’architecture des accords franco-algériens. Ces accords sont composés d’une part des accords d’Evian, c’est-à-dire de l’accord de cessez-le-feu et des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, approuvés par le peuple français par le référendum du 8 avril 1962. Dans la mesure où, lors des négociations, les autorités françaises pensaient que les Français d’Algérie allaient majoritairement rester en Algérie la contrepartie a été de prévoir le maintien d’un régime de liberté de circulation pour les Algériens, sous la seule condition de présentation d’une carte d’identité, et d’égalité des droits, à l’exception des droits politiques. Mais on sait que non seulement les « pieds noirs » ont massivement rejoint la Métropole en 1962 mais en outre près de 500 000 travailleurs algériens ont immigré en France. Dès 1963, les autorités françaises ont tenté de maîtriser ce flux, notamment par des motifs sanitaires et en créant – clandestinement – le premier centre de rétention à Arenc. Le 10 avril 1964 un premier accord temporaire est conclu.
L’accord de 1968 visait donc à maîtriser ces flux, notamment en instaurant un contingentement de 35 000 travailleurs algériens par an (abandonné par la suite) et en encadrant leur séjour des Algériens en France par l’instauration d’un certificat de résidence algérien (CRA). Mais contrairement à ce qu’affirme, sans fondement, Xavier Driencourt l’accord de 1968 n’a nullement abrogé implicitement la déclaration du 19 mars 1962. Bien au contraire, cet accord fait expressément référence « à la déclaration de principe des accords d’Évian » et le Conseil d’Etat a déjà reconnu son application réciproque.
En cas de dénonciation de l’accord de 1968, et de ses différents avenants, cela aurait pour effet de rétablir les facilités de circulation des Algériens pour se rendre en France alors que justement l’accord de 1968 et ses différents avenants ont visé à encadrer leur séjour en France. Il est tout aussi faux, pour l’ancien ambassadeur, d’affirmer que « la dénonciation de l’accord ferait basculer les ressortissants algériens dans le droit commun des accords de Schengen ». En effet, d’une part, comme pour tous les autres ressortissants de pays tiers, l’entrée des Algériens en France pour des courts séjours (moins de 3 mois) est déjà régie, depuis 1995[2], par la convention d’application des accords de Schengen ainsi que par les différents règlements européens régissant l’espace Schengen et en cas de dénonciation de l’accord de 1968 elle le resterait. Mais le système Schengen n’empêche pas complément les Etats membres d’accorder, par voie d’accords bilatéraux, à certaines nationalités des facilités de circulation. Et, d’autre part, la législation européenne ne régit nullement les visas de long séjour en vue d’une installation. Or, en réalité les accords d’Evian instauraient non seulement un régime de liberté de circulation mais aussi de liberté d’installation[3].
En second lieu, les accords franco-algériens sont loin d’être essentiellement favorables aux Algériens, compte tenu des évolutions du droit commun des étrangers depuis 2001.
En quoi le statut des Algériens en France ne serait pas réellement plus favorable à celui des étrangers relevant du droit commun (CESEDA) ?
On peut en effet se demander si aujourd’hui les Algériens tirent plus d’avantages que d’inconvénients à être régis par un statut spécifique issu de l’accord franco-algérien de 1968 modifié. En l’absence de renégociation de l’accord franco-algérien depuis 2001, le statut des Algériens reste « bloqué » à l’état du droit français issu de la loi « Chevènement » en 1998 : les ressortissants algériens n’ont donc pas accès à de nombreux titres de séjour et dispositifs favorables : passeports talents, cartes pluriannuelles, titre de séjour pour motifs humanitaires comme les victimes de la traite ou de violences conjugales, droit au travail des étudiants internationaux, dispositif de changement de statut des étudiants internationaux par la carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou encore les mécanismes légaux de régularisation.
Rappelons que, de jurisprudence constante, le Conseil d’Etat estime que cet accord « régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ». On distingue donc les dispositions « de fond » du CESEDA, inapplicables aux Algériens, et les dispositions de procédure qui leur sont applicables, à savoir les règles régissant l’entrée mais aussi l’éloignement (OQTF, expulsions, etc.), l’accès au marché du travail (autorisation de travail, etc.) ainsi que les règles répressives – c’est-à-dire les aspects les plus défavorables du CESEDA.
Certes, du fait de l’accord, les ressortissants algériens bénéficient de dispositifs spécifiques favorisant l’installation durable (accès la carte de résident, conditions du regroupement familial[4], prise en compte de la kafala, installation des artisans et commerçants, etc.) et les conditions de retrait des certificats de résidence algériens sont plus limitées que ceux du droit commun. Et si la condition d’intégration n’est pas systématiquement exigée des Algériens par l’accord franco-algérien, cela n’empêche ceux-ci d’être, selon le rapport annuel de l’OFII, en 2021 la… troisième nationalité bénéficiaire du Contrat d’intégration républicaine.
Si l’on fait la balance, il n’est pas acquis qu’en cas de renégociation de l’accord de 1968 les Algériens aient plus à perdre qu’à gagner à un rapprochement de leur statut avec le droit commun.
En tout état de cause, alors que la France délivrait, en 2017, 411 979 visas à des Algériens, il en a été accordé seulement 131 264 en 2022 Une telle baisse drastique s’explique par la décision des autorités françaises de diminuer de 50% le nombre de visas délivrés pour amener les autorités algériennes à accorder davantage de laissez-passer consulaires pour éloigner les irréguliers[5]. On ne peut donc valablement affirmer, comme le fait Xavier Driencourt, que « l’accord de 1968 prive le législateur et le gouvernement français de la possibilité d’agir significativement sur les flux en provenance de l’Algérie. ».
[1] Cf. principalement : Sylvain Laurens, Une politisation feutrée. Les hauts fonctionnaires et l’immigration en France (1962-1981), Belin, coll. « socio-histoires », 2009, p.83. V. aussi Patrick Weil, La France et ses étrangers, Calmann-Lévy, p.67 qui note que l’accord conclu en 1968 est « annexé aux accords d’Evian ».
[2] Dès 1986, à la suite d’attentats terroristes, la France avait, à l’initiative de Charles Pasqua, unilatéralement rétabli l’exigence de visas courts séjour.
[3] v. les déclarations de Patrick Weil en ce sens dans : « Immigration : faut-il crever l’abcès avec l’Algérie ? », L’Opinion, 07 juin 2023
[4] En 2021, cela représente… 2 893 demandes de regroupement familial d’Algériens …
[5] « Comprendre la querelle sur les chiffres de l’immigration illégale entre la France et l’Algérie », Le Monde, 15 oct. 2021 ; « Fin de la crise des visas entre la France et l’Algérie, qui reprennent une relation consulaire « normale » », Le Monde avec AFP, 18 déc. 2022 ; « Le calvaire des Algériens pour obtenir un visa », Le Monde, 9 nov. 2022
[vcex_button url= »https://www.leclubdesjuristes.com/newsletter/ » title= »Abonnement à la newsletter » style= »flat » align= »center » color= »black » size= »medium » target= » rel= »none »]En savoir plus…[/vcex_button]