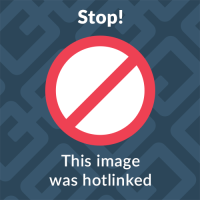Plainte contre Mélenchon pour injure publique : sur quelle base et pour quel intérêt ?
Mécontent de l’interdiction d’une conférence de la France insoumise à l’université de Lille, Jean-Luc Mélenchon aurait dressé un parallèle entre Adolf Eichmann et le président de ladite université. Le 29 avril, la ministre de l’enseignement supérieur a annoncé que son ministère portait plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Sur quelle base ?

Par Jean-Baptiste Thierry, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de Lorraine
Quelle est l’infraction visée ?
La ministre de l’enseignement supérieur a annoncé que la plainte concernerait l’injure publique. L’injure est définie au second alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». À la différence de l’outrage, l’injure résulte de la publicité des propos et n’est pas adressée directement à la personne concernée.
Lorsqu’elle est commise contre un particulier, l’injure fait encourir une peine d’amende de 12 000 euros. Depuis la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, lorsque l’injure est commise contre certaines personnes, une peine de travail d’intérêt général est également encouru à titre principal. Pour que l’aggravation s’applique, il faut que l’injure ait notamment été commise, « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, […] envers un fonctionnaire public ». Un président d’université est bien un fonctionnaire public, comme l’a déjà précisé la Cour de cassation. Il faut ajouter qu’à la différence d’une injure commise contre un particulier, l’injure envers un fonctionnaire n’est pas susceptible d’être justifiée par l’excuse de provocation.
Soit dit en passant, l’insertion du TIG comme peine principale est surprenante, puisque cette peine ne peut être ordonnée qu’avec le consentement du condamné. Habituellement, lorsque le TIG est envisagé comme une alternative à la peine d’emprisonnement, le refus du condamné de subir le TIG permet au juge de décider de l’emprisonnement. Or, dans le cas présent, le refus du TIG par le condamné empêche tout simplement le prononcé de la peine. Si l’on ajoute que la non-exécution d’un TIG expose la personne concernée à une peine d’emprisonnement et une peine d’amende de 30 000 euros, on comprend que le condamné a tout intérêt à refuser cette peine.
La ministre peut-elle déposer plainte en raison de propos visant le président de l’université ?
Oui. Le ministère public ne peut d’ailleurs pas poursuivre ce type d’injure de sa propre initiative : une plainte préalable est nécessaire. Cette hypothèse est expressément prévue au 3° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux termes duquel « Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ». La ministre semble ici suppléer la décision du président de l’université de Lille et sa plainte pourrait intervenir alors même que celui-ci ne souhaiterait pas agir. C’est signe que le fonctionnaire est un peu plus que sa seule personne : il incarne une valeur supplémentaire que le ministre protège. Il est donc nécessaire que les propos aient bien visé le président de l’université en raison de sa fonction. Tel semble bien être le cas en l’espèce dans les propos de Jean-Luc Mélenchon.
Quelles peuvent être les suites d’une telle plainte ?
En premier lieu, aussi regrettables que soient les propos en cause, il n’est pas certain qu’ils soient constitutifs d’une injure. Sans reprendre l’intégralité du discours, il semble que les propos litigieux soient les suivants : « Nous ne nous méfions pas seulement des fascistes mais plus encore peut-être des lâches, des faibles, ceux qui dans la chaîne interminable du mal signent un papier pour organiser un convoi SNCF, qui signent des papiers pour donner des ordres à la police. Moi je n’ai rien fait disait Eichmann, je n’ai fait qu’obéir à la loi telle qu’elle était dans mon pays. Alors ils disent qu’ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l’université dont on me dit que par ailleurs c’est un brave homme, ce que je veux bien croire, mais à l’instant où il avait à décider, il n’était plus un brave homme singulier, il était le président d’une université, c’est-à-dire d’un lieu de la liberté de l’esprit où il faut quoiqu’il en coûte tenir bon pour la liberté. Parce que c’est son rôle. Alors il s’est aplati, il s’est couché ». Ces propos montrent que le président de l’université n’a pas été directement qualifié de nazi. Il semble que la ministre ne visait pas les propos relatifs à la lâcheté prétendue du président de l’université. Quant au parallèle fait entre l’interdiction d’une conférence et la déportation des juifs pendant la Seconde guerre mondiale, on peut déplorer la grossièreté rhétorique sans pour autant considérer qu’il s’agit d’une injure méritant d’être réprimée.
Car en effet, en second lieu, pour constituer une injure le propos doit dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression. Des propos outrageants peuvent ne pas dépasser ces limites en fonctions du contexte dans lequel ils ont été tenus. Par exemple, la Cour de cassation a pu considérer que les mots « salope fascisante », exprimaient « l’opinion de leur auteur sur un mode satirique, dans un contexte polémique, au sujet des idées prêtées au responsable d’un parti politique, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Comme cela a déjà été dit dans une précédente contribution, les hommes et femmes politiques bénéficient d’une plus grande latitude que le commun des mortels dans l’exercice de leur liberté d’expression. La CEDH relève que « l’article 10 par. 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général ». Par exemple, dans un arrêt Haguenauer c. France du 22 avril 2010, la Cour européenne des droits de l’homme avait pu considérer que la condamnation d’une élue pour des paroles proférées en réponse aux déclarations d’un président d’université, lors d’une manifestation sur une question d’ordre national particulièrement sensible constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa liberté d’expression. Elle juge ainsi que, dans le cadre d’un débat public d’intérêt général, il « est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos ». On le voit, dans le cadre d’un débat d’intérêt général – ce que constitue à l’évidence l’annulation d’une conférence sur la Palestine dans une université –, il n’est pas évident de considérer que la réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon ait dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
À cet égard, la plainte de la ministre de l’enseignement supérieur est une réaction plus politique que juridique, destinée à assurer le président de l’université de Lille de son soutien au regard de la décision prise, sans réelle considération pour les chances de réussite. Au reste, les suites de la plainte interviendront dans plusieurs mois, ce qui relativise assez largement l’intérêt de porter plainte.